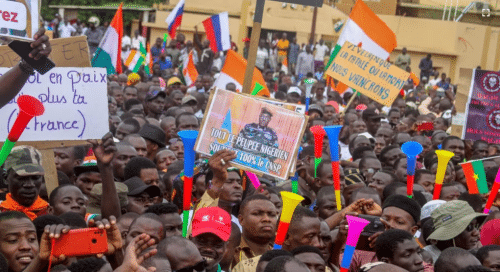Saïd Abtout : « Je n’oublierai jamais »

Le poids des ans n’a pas altéré la mémoire du militant communiste. À 91 ans, les souvenirs de cette terrible journée restent vifs et douloureux.
Le 16 octobre au soir, un responsable du FLN lui a dit : « Demain soir, on manifeste au Quartier latin. C’est non violent, il ne faut rien avoir sur soi, même pas un petit canif. » Bien que réticent, parce que lucide au sujet des risques de représailles, Saïd Abtout s’est rendu à la manifestation du 17 octobre, « par discipline », explique-t-il.
Alors secrétaire de la section du Parti communiste algérien pour une zone allant d’Issy-les-Moulineaux à Montreuil, Saïd Abtout avait adhéré à la Fédération de France du FLN. Son engagement fut précoce. Il avait 15 ans lorsque les émeutes du 8 mai 1945 ont été « réprimées dans le sang » à Kherrata, Sétif et Guelma.
Aussi, ce jour d’octobre 1961, il fallait être présent. « Parce que le couvre-feu, c’était la mort du FLN. Or, la question algérienne passait à l’ONU, nous devions maintenir la pression. »
Saïd Abtout avait 31 ans, il habitait à Sceaux et était employé à la mairie de Bagneux. Comme à son habitude, il avait fait un crochet à la FSGT, dont il était adhérent et initiateur de ski de montagne, avant de rejoindre le cortège des manifestants. « J’étais pratiquement en tête, à dix mètres du cordon de sécurité. Les policiers matraquaient et continuaient à cogner avec leurs chaussures sur les manifestants à terre. C’était horrible à voir, les Algériens ne ripostaient pas. » Saïd Abtout ne s’attendait pas à « un tel déchaînement de violence. Un carnage », souffle-t-il, encore sous le choc. « On a tabassé des gens qui avaient les mains dans les poches. Je n’oublierai jamais. »
À l’indépendance, l’été 1962, Saïd retourne dans son pays. Il est envoyé à Prague par son parti pour une formation de typographe. Il y rencontre Henri Alleg, qu’il retrouvera ensuite au journal Alger républicain.
Saïd Abtout, l’un des rares témoins de la tragédie d’octobre 1961, a connu mille vies en une. Adolescent, il fut berger dans sa Kabylie natale. En 1948, il émigre en France, travaille à l’usine, s’engage à la CGT puis au PCF, le 1er mai 1954. Il rejoindra peu après la résistance algérienne. Il sera tour à tour maçon, conducteur de transports en commun ou encore projectionniste.
Autodidacte, il suit les cours du soir d’économie politique à l’Université nouvelle, « lieu de rencontre d’intellectuels et d’ouvriers », rappelle-t-il avec une pointe de fierté et de nostalgie. Saïd a fait l’école centrale du parti, il a été diffuseur de l’Humanité Dimanche, de la Vie ouvrière et de l’Algérien en France.
Sport, syndicat et politique, ce triptyque n’a jamais quitté celui qui se réclame, avant et après tout, de l’internationalisme. Cela fait vingt ans désormais qu’il partage ses vieux jours entre les deux rives, à Boudjima, en Kabylie, et à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine.
Mohamed Ghafir : « Cette histoire appartient aussi bien à la France qu’à l’Algérie »
Il vit actuellement en Algérie, mais on l’appelle toujours Moh Clichy. C’est dans cette ville des Hauts-de-Seine qui l’a fait citoyen d’honneur, le 17 octobre 2007, que Mohamed Ghafir débarque de sa Kabylie natale en 1955. Il a 21 ans. Assez vite, il rejoint le FLN, dont il devient un des responsables pour la banlieue nord. Il est un des meneurs de la grève des huit jours à la fin de janvier 1957. Surveillé en raison de ses activités pour la cause de l’indépendance, Mohamed Ghafir est arrêté par la DST le 9 janvier 1958. Il est emprisonné durant trois années à Fresnes. À sa sortie, il reprend aussitôt du service et se retrouve parmi les organisateurs de la manifestation du 17 octobre. Il explique : « En 1957, notre dirigeant national, Abane Ramdane, avait donné des instructions claires : si la France ne reconnaît pas le droit à l’indépendance du peuple algérien, on transporte la guerre sur le sol de l’ennemi. C’est ce qui s’est produit. Le 25 août 1958, nous avons déclenché une révolution en métropole, en ciblant des objectifs militaires et économiques. Ensuite, le général de Gaulle voulait bien négocier mais il voulait garder le Sahara, alors que le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) défendait l’intégrité du territoire.
En janvier 1961, un référendum en France se prononce pour l’autodétermination. À partir de là, Michel Debré, premier ministre, Roger Frey, ministre de l’Intérieur, et Maurice Papon, préfet, agissent à l’encontre de cette volonté. Le 5 octobre 1961, ils décrètent un couvre-feu à Paris et banlieue, applicable de 20 heures à 5 heures du matin aux seuls Français musulmans algériens, comme on nous appelait à l’époque. Un millier de policiers et gendarmes sont mobilisés, ainsi que des supplétifs, les harkis ramenés spécialement d’Algérie.
Nous avons, la Fédération de France du FLN, en accord avec le GPRA, décidé d’une manifestation pacifique le 17 octobre, à 20 heures, dans Paris, à laquelle devaient participer tous les Algériens, y compris les femmes et les enfants. La consigne était qu’ils devaient être correctement habillés, disciplinés et sans armes. La suite, on la connaît. Les militants du réseau Jeanson nous informaient des é vénements durant la soirée et la nuit du 17. Des centaines de morts, des corps jetés à la Seine. Le massacre est connu. Il faut qu’il soit reconnu. »
À Alger, où il se trouve, Moh Clichy s’apprête à commémorer les 60 ans de la bataille de Paris, « une bataille politique du FLN dans l’émigration. Elle a joué un rôle important dans la lutte de libération nationale », insiste-t-il. « Cette histoire appartient aussi bien à la France qu’à l’Algérie. » L. M.
Djamila Amrane : « Ce n’était pas Paris ville lumière mais Paris ville de sang »
Son féminisme s’est forgé au cœur de la cause pour l’indépendance de l’Algérie. Militante et jeune maman, elle avait manifesté sur les Grands Boulevards.
Djamila Amrane est née à Saint-Denis, rue Danielle-Casanova, tient-elle à préciser. Enseignante à la retraite, elle vit aujourd’hui à Saint-Ouen. Agent de liaison de la Fédération de France du FLN, elle était chargée de monter un groupe de femmes pour participer à la manifestation du 17 octobre contre le couvre-feu. « Une marche pacifique. Il n’était pas question de porter quoi que ce soit qui puisse être assimilé à une arme, même pas une épingle à nourrice. » Sur le boulevard Bonne-Nouvelle, la foule est immense. Et calme. Mais les policiers matraquent à tout va. Djamila a peur. Elle a 25 ans, dans les bras, Salem, son bébé de 3 mois. Elle court, elle enjambe des corps ensanglantés. Elle entend des policiers demander à des manifestants s’ils savent nager.
Les images se bousculent dans sa tête, mais elle n’a jamais oublié le visage de cette dame qui l’a agrippée pour l’engouffrer dans le hall de son immeuble et la mettre à l’abri. « Ce soir-là, ce n’était pas Paris ville lumière mais Paris ville de sang. Des gens à terre étaient brutalisés, on les a jetés à la Seine. Ils étaient sans armes, ils étaient juste venus réclamer le droit de vivre normalement. »
Si elle commémore chaque année le 17 octobre, ce n’est, assure Djamila, « ni par vengeance ni par haine, mais pour ne pas qu’on oublie que des centaines d’Algériens ont été tués en plein Paris ».
Cela faisait déjà quelques années que Djamila Amrane, fille d’un soldat de 14-18, subissait la répression coloniale : perquisitions, gardes à vue, interrogatoires. Il faut dire qu’elle collectait des fonds et organisait des réunions de femmes dans la clandestinité. Son mari avait été relégué au camp du Larzac de 1959 à 1962.
Elle a longtemps refoulé ces pages sombres « de peur de faire du mal à mes enfants », tente-t-elle d’expliquer. La parole a commencé à se libérer à la fin des années 1980 grâce à son implication dans l’association Africa, qu’elle a cofondée en 1987 et dont elle fut la présidente.
Pour cette militante, la cause féministe allait de pair avec celle de l’indépendance. « Je voulais l’indépendance pour libérer les femmes. Elles n’étaient que des bonnes à tout faire, elles n’avaient pas le droit aux études, contrairement à nous qui étions en France. J’étais choquée de voir à quel point elles étaient maintenues dans l’ignorance. »
Toujours active dans la vie associative et citoyenne, Djamila Amrane ne ménage pas ses efforts pour transmettre la vérité. « Le 17 octobre est une date importante. La jeunesse doit connaître cette histoire. L’État français doit la reconnaître. Il est plus que temps. » Ce 13 octobre, avec l’association Au nom de la mémoire, Djamila Amrane avait rendez-vous avec des collégiens de Stains. Le 16 octobre, c’est elle qui dévoilera, aux côtés du maire, la plaque dédiée sur le quai de Seine à Saint-Ouen. L. M.
17 octobre 1961. Emmanuel Macron reconnaît des « crimes inexcusables pour la République » mais pas le rôle de l’État

Le président s’est rendu à Colombes et a déposé une gerbe de fleurs en bord de Seine. Une première pour un chef d’État en exercice. Mais le geste laisse un arrière-goût d’inachevé. L’Élysée avait prévenu en amont : pas de discours. Alors c’est par un bref communiqué que l’exécutif s’est exprimé. Dans celui-ci, Emmanuel Macron reconnaît des « crimes inexcusables pour la République » le 17 octobre 1961, « commis cette nuit-là sous l’autorité de Maurice Papon ». « La France regarde toute son Histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies », peut-on également y lire.
Interrogé sur l’absence de discours solennel, le palais a répondu que la seule présence physique du président sur un lieu de mémoire suffit à marquer l’importance du moment. Il est vrai qu’en se rendant à Colombes (Hauts-de-Seine) pour déposer une gerbe de fleurs en bord de Seine, Emmanuel Macron est devenu le premier chef d’État en exercice à participer à une commémoration du 17 octobre 1961, soixante ans après le massacre. Il a observé une minute de silence au pied du pont de Bezons, qui relie Colombes à Nanterre, et d’où étaient partis, à l’époque, un cortège de manifestants en provenance du bidonville de Nanterre. Ils s’étaient rassemblés pacifiquement contre le couvre-feu qui visait spécifiquement les « Français musulmans d’Algérie » (FMA), comme on les qualifiait à l’époque. C’est là aussi que furent repêchés dans le fleuve plusieurs corps de « FMA », assassinés par la police.
La reconnaissance des faits par Emmanuel Macron laisse cependant un arrière-goût d’inachevé. On a connu le chef de l’État plus grandiloquent et prolixe en matière de mémoire, confère ses discours pour le bicentenaire de Napoléon, les 150 ans de la Troisième République ou encore son adresse aux Harkis. Surtout, s’il reconnaît « des crimes inexcusables pour la République », il n’évoque pas des crimes « de » la République. Une nuance importante, bien que malheureusement attendue, car l’Élysée avait balayé toute volonté de « repentance ». Dans son communiqué, le président impute l’essentiel de la responsabilité à Maurice Papon, préfet de police de Paris à l’époque. Mais il n’évoque pas le gouvernement qui l’avait nommé expressément pour ses compétences en matière de « maintien de l’ordre » sanglant au Maroc et en Algérie. Le rôle de Michel Debré, premier ministre et forcément mis au courant de la manifestation, n’est pas non plus à l’ordre du jour.
Ainsi, les associations de descendants de victimes et pour la mémoire du 17 octobre 1961, dont certaines demandaient à la fois la reconnaissance d’un « massacre d’État » mais aussi d’un « mensonge d’État » (la dénégation des violences policières), n’ont pas été pleinement entendues. La question du plein accès aux archives, elle aussi, reste sensible, alors que certaines dépouilles de disparus n’ont jamais été retrouvées.
Source : L’humanité