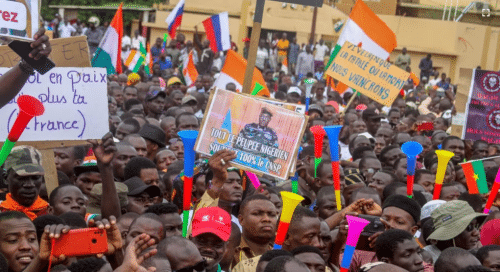BEN ALI, 21 ANS DE RÈGNE : Tunisie : un peuple infantilisé, une tyrannie banalisée
AURA-T-IL 100%, un peu moins, …un peu plus ? Le président tunisien, vingt-et-un ans de pouvoir aujourd’hui, maintient, rien que de très banal, le suspense. D’ores et déjà programmée pour 2009, son énième reconduction plébiscitaire laisse de ce fait entière cette deuxième question : le peuple qu’il gouverne est-il considéré comme mature ou immature ? Non spécifique à la Tunisie, cette problématique s’inscrit en revanche explicitement dans les discours de ses gouvernants, au point de ponctuer les changements de régime de son histoire contemporaine. C’est en reconnaissant aux élites tunisiennes les qualités requises pour gouverner que, à Carthage, à l’été 1954, Pierre Mendès France amorce la fin du Protectorat français. Et c’est pour sa part lors du coup d’Etat du 7 novembre 1987 que Zine Ben Ali interrompt le règne de Habib Bourguiba, en proclamant que les Tunisiens en général sont à même de gérer leurs propres affaires.
Mais alors que la démocratie n’était pas une priorité de l’ancien régime, le nouveau potentat va, lui, s’en réclamer et, du même mouvement, en faire litière. Cet autoritarisme ubuesque n’est cependant pas une création ex nihilo. Il dérive d’un long processus, antérieur, d’infantilisation du peuple et, en miroir, de ses dirigeants.
La Tunisie n’était pourtant pas si mal partie. Après l’indépendance en 1956, l’édification jacobine d’un Etat-nation s’appuie sur une émancipation des femmes, une scolarisation massive, et un système éducatif des plus ambitieux : la jeunesse n’est pas seulement alphabétisée, mais lettrée, empreinte aussi d’une tolérance religieuse inégalée dans le monde musulman. Mais la santé soudain déclinante du chef de l’Etat entame une interminable guerre de succession, qui sape subrepticement ces efforts de modernisation. A partir d’une première crise cardiaque en 1967, et d’une dépression devenue chronique, la disparition de Bourguiba est l’objet de spéculations à court terme …vingt ans durant. La course à la présidence accapare les hommes forts successifs du régime qui, mus par l’obsession d’être Calife à la place du Calife, échouent tour à tour à proximité du but.
Le succès de « l’homme du changement » est ainsi celui d’un Iznogoud qui a réussi. Au-delà même de ses espérances. Trente ans plus tôt, la déposition du Bey de Tunis avait procédé d’une Assemblée constituante instituant une République. En revanche, avec la destitution de son patriarche, subjuguée par son tombeur, l’ensemble de la classe politique, dont le président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme Mohamed Charfi, contourne la Constitution ; elle signe avec le putschiste un Pacte national qui enjoint aux Tunisiens de se sacrifier pour la bonne cause ; et porte comme un seul homme, au printemps 1989, sa première candidature unique à l’élection présidentielle. Matrice de la Tunisie post-bourguibienne, cette mascarade de notables en quête de maroquins est dans la continuité des politiques de crétinisation de masse auparavant menées à l’ombre du crépusculaire « combattant suprême ».
Car le non-dit prime au sommet. Ainsi, malgré l’arrêt brutal de l’expérience socialiste des années 1960, le tout-puissant Parti socialiste destourien (PSD) conserve son nom, et consacre durant la décennie 1970 le libéralisme à la Guizot du Premier ministre Hédi Nouira. Palliant son absence d’assise idéologique, ce capitalisme sauvage, qui essaime affairisme et corruption, impose comme si de rien n’était au pays la promotion de la seule identité arabe et musulmane. Traduisant une peur d’affronter un peuple éduqué, l’Enseignement public est sournoisement dépouillé de tout ce qui pourrait donner des idées subversives ; il tend à former des ingénieurs au fait des nouvelles techniques mais à la conscience politique réprimée. A l’Université, le pouvoir encourage même un courant intégriste, histoire d’épauler son entreprise d’éradication des esprits critiques.
Une réforme de l’Education a bien essayé d’en extirper l’intégrisme dans les années 1990. Mais avec un islam d’Etat désormais porté par le non moins tout-puissant Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), les Seventies tunisiennes sont, aujourd’hui encore, à l’œuvre. L’émergence de leurs rejetons, des mouvances islamistes antérieurement inexistantes, permet de faire la part belle aux réponses sécuritaires, qui, plus que jamais à la faveur du 11 Septembre, écrasent l’expression de toute différence. Résultat, c’est dans la rue que les conflits culminent. Déjà, la grève générale du 26 janvier 1978 avait marqué l’échec de l’« Enrichissez-vous » au seul profit de quelques-uns. Les émeutes du pain du 3 janvier 1984 avaient, elles, sanctionné la mauvaise gestion des finances publiques par le gouvernement Mzali. A l’été 1987, les islamistes cristallisent les mécontentements, tentent de déstabiliser un régime affaibli par une crise financière internationale, et ouvrent par la même occasion une voie royale au patron de la sécurité, le général Ben Ali. De nos jours, en 2008, c’est la fronde du bassin minier de Gafsa qui brise l’image d’Epinal du miracle économique d’une Ere nouvelle régentée par une quasi-oligarchie familiale, qui y a dépêché rien de moins que l’armée.
Mais c’est également en politique étrangère que les citoyens sont réduits au vulgum pecus. Là encore, le débat est interdit. Une sourde rupture de l’ancien équilibre géostratégique du pays entre un Proche-Orient musulman et un Occident judéo-chrétien est imposée. De facto limitée aux échanges mercantiles, la collaboration de la Tunisie, naguère au processus euroméditerranéen de Barcelone, et à présent à l’Union pour la Méditerranée de Nicolas Sarkozy, est à cet égard l’arbre qui cache la forêt. La prépondérance est plutôt, l’air de rien, à la dilution de la personnalité tunisienne dans le folklore panarabe. Parmi d’autres, un signe qui ne trompe pas : pourtant commanditaire d’une tentative, avortée, de renversement du régime en janvier 1980, le colonel Kadhafi est, depuis l’éviction de Bourguiba, le partenaire privilégié d’une amitié présidentielle qui achève de mettre la Tunisie du 7 novembre 87 à l’unisson de la Libye du coup d’Etat militaire du 1er septembre 69. Et de lui faire rejoindre la tragique banalité des tyrannies du monde arabe.
Mais à quelque chose malheur est bon. Ben Ali aura sans doute réactualisé en Tunisie un enseignement universel de toujours : se méfier des hommes providentiels.
Wicem Souissi
http://www.afrique-du-nord.com/article.php3?id_article=1451